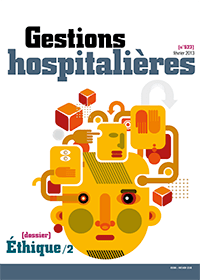De par sa vocation historique dâhospice, lâhÃīpital met en avant ses bonnes Åuvres : accueillir, prÃĐvenir, ÃĐduquer et soigner. Toutefois, son ÃĐvolution contemporaine semble Être celle de lâentreprise : financiarisation, mise en concurrence, culture managÃĐriale anglo-saxonne. Les gestionnaires adoptent un discours de la performance calquÃĐ sur le sport ou la guerre (ÃĐconomique), des comparaisons commodes pour homogÃĐnÃĐiser les pratiques sociales dans un but unique qui nâest plus celui du soin. Il y a une forme de nÃĐcessitÃĐ extÃĐrieure qui impose la discipline et fait plier les vellÃĐitÃĐs de gentillesse. Alors, lâhospitalier peut-il encore Être gentil ? Quel service rend le service public ? Entretien avec Emmanuel Jaffelin, philosophe.
Dans la premiÃĻre partie de votre livre, Petite Philosophie de lâentreprise (1), vous donnez une dÃĐfinition simple de lâentreprise : ÂŦ Ensemble de moyens qui produit de la richesse en exploitant la nature, en fabriquant des objets ou en rendant des services Âŧ, puis vous dÃĐfinissez ses antinomies. Quelles sont-elles ? La premiÃĻre antinomie repose sur lâidÃĐe selon laquelle lâentreprise est en train de se dÃĐrÃĐaliser et donc de se virtualiser, câest-à -dire de se retirer de son assise physique et surtout humaine. à partir des annÃĐes 1980, lâentreprise a considÃĐrÃĐ que le salariÃĐ coÃŧtait cher et quâil nâÃĐtait pas seulement une charge mais une variable dâajustement. Mais lâentreprise est allÃĐe plus loin : elle cherche aujourdâhui à exister avec le moins de salariÃĐs possible, devenant un cabinet de marketing qui sous-traite la totalitÃĐ de sa production. De la mÊme maniÃĻre que les ÃĐcologistes invitent lâhomme à rÃĐduire son empreinte carbone sur la planÃĻte, lâentreprise virtuelle cherche à se dÃĐmatÃĐrialiser, se contentant dâappliquer sa marque sur des produits fabriquÃĐs en Asie et vendus urbi et orbi. Cette entreprise fantÃīme â ...
Identifiez-vous ou créez un compte si vous ne l'avez pas encore fait. Cela vous permet de :
- Lire la suite des articles gratuits (marqués d'une puce verte).
- Lire la suite des articles payants (marqués d'une puce rouge).
Pour les abonnés, pensez à bien renseigner dans votre profil votre numéro d'abonné pour activer la lecture des articles payants.