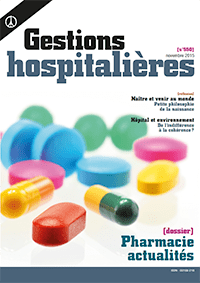Les curares constituent une famille de mÃĐdicaments dÃĐcouverte au XVIe siÃĻcle par les Indiens dâAmÃĐrique du Sud. Il sâagissait pour eux dâun poison avec lequel ils enduisaient leurs flÃĻches (1). Lâobjectif de notre travail a portÃĐ sur les curares non dÃĐpolarisants. En 2012, le service de pharmacie a ÃĐlaborÃĐ une fiche de bon usage des curares non dÃĐpolarisants qui prÃĐconisait lâemploi de lâatracurium. En 2014, lâarrivÃĐe des gÃĐnÃĐriques du Nimbex (cisatracurium) et les changements de marchÃĐ ont entraÃŪnÃĐ une baisse importante du prix unitaire du cisatracurium, le prix unitaire de lâatracurium ÃĐtant quant à lui restÃĐ stable. Le cisatracurium serait donc devenu plus avantageux ÃĐconomiquement. Nous avons souhaitÃĐ ÃĐvaluer les pratiques mÃĐdicales en cas de recours à la curarisation en rÃĐanimation et avons tentÃĐ de comparer les rapports coÃŧt/efficacitÃĐ de lâatracurium et du cisatracurium.
Il existe deux types de curareâ: les curares dÃĐpolarisants, reprÃĐsentÃĐs par le chlorure de suxamÃĐthonium, sont des agonistes non compÃĐtitifs de lâacÃĐtyl choline et se lient notamment aux rÃĐcepteurs nicotiniques à lâacÃĐtyl choline de la plaque motrice. La stimulation de ces rÃĐcepteurs entraÃŪne leur ouverture, ce qui est à lâorigine dâune dÃĐpolarisation de la plaque motrice, justifiant ainsi la dÃĐnomination ÂŦâcurares dÃĐpolarisantsâÂŧ. Du fait dâune prÃĐsence prolongÃĐe du curare dÃĐpolarisant dans la fente synaptique, il y a dÃĐsensibilisation du rÃĐcepteur et donc inexcitabilitÃĐ de la fibre musculaire, ce qui provoque la paralysieâ(2). Cette molÃĐcule a un dÃĐlai et une durÃĐe dâaction brefs(3)â; les curares non dÃĐpolarisants sont des antagonistes compÃĐtitifs de lâacÃĐtyl choline. En effet, ils se lient aux rÃĐcepteurs cholinergiques au niveau de la plaque motrice de la jonction neuro-musculaireâ(4). Ils empÊchent lâouverture des canaux cationiques et la dÃĐpolarisation du muscleâ(5) dâoÃđ leur nom de curares non dÃĐpolarisants. Ils permettent ainsi une paralysie des muscles en quelques minutes â de 1,5 à 4 minutes en ...
Identifiez-vous ou créez un compte si vous ne l'avez pas encore fait. Cela vous permet de :
- Lire la suite des articles gratuits (marqués d'une puce verte).
- Lire la suite des articles payants (marqués d'une puce rouge).
Pour les abonnés, pensez à bien renseigner dans votre profil votre numéro d'abonné pour activer la lecture des articles payants.